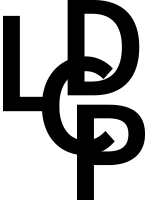D’un côté, Christophe Pellet, auteur dramatique singulier, au verbe bien acéré. De l’autre, Erich Von Stroheim, grand réalisateur du cinéma muet, qui prête son nom à la nouvelle pièce de l’auteur. Parallèle amusant qui réunit la violence des mots et un univers silencieux jugé, à l’époque, scandaleux et excessif. Aujourd’hui, la censure n’existe plus et sur la scène du Théâtre du Rond-Point, sous la houle de Stanislas Nordey, il ne sera pas question de cinéma, mais d’amour, de sexe et de corps qui se cherchent.
D’un côté, Christophe Pellet, auteur dramatique singulier, au verbe bien acéré. De l’autre, Erich Von Stroheim, grand réalisateur du cinéma muet, qui prête son nom à la nouvelle pièce de l’auteur. Parallèle amusant qui réunit la violence des mots et un univers silencieux jugé, à l’époque, scandaleux et excessif. Aujourd’hui, la censure n’existe plus et sur la scène du Théâtre du Rond-Point, sous la houle de Stanislas Nordey, il ne sera pas question de cinéma, mais d’amour, de sexe et de corps qui se cherchent.
Pour une fois, l’homme est objet, victime de la femme. Elle le considère comme son esclave sexuel, un animal à sa merci, qu’elle contrôle à sa guise, selon ses désirs. Femme de tête et femme d’affaires, elle dicte les règles et mène la partie. Elle est l’unique et la seule à être maîtresse de son existence et de son corps.
Le sexe est omniprésent, autant dans la représentation des corps nus, que dans le quotidien des deux hommes, que dans l’air. L’un se prostitue pour gagner sa vie, l’autre lui offre ses bras et son lit pour le réconforter. Offrir son corps à des connus, c’est accepter de sortir de celui-ci et de s’oublier. Tous les trois, ils forment un trio interchangeable. Le troisième, prétexte, permet d’attiser la jalousie et de créer de la peur et de la dépendance chez les deux autres. De conserver le jeu et le fantasme d’appartenir à l’autre ou de le posséder. Sans l’autre, il n’y a pas de considération de soi et de son corps, aucune image n’est renvoyée. Le troisième n’est qu’un alibi. Il est dépendant des autres, car seul, sans amour et sans le regard de l’autre, il est inexistant et se meurt. Une fois le troisième évincé, le rationnel introduit la notion de couple. Le couple ne retranscrit pas seulement de l’amour. Pour eux, il symbolise la mort de quelque chose. Une mort qui laisse place à la naissance d’un enfant. Comment accueillir le fruit de ses entrailles au milieu d’un tel chaos ? Que pouvons-nous offrir aux nouvelles générations ? Venant de personnes, sans noms, perdues et semblant représenter l’univers : de la violence et de la dépossession. « Je te tiens en laisse. Tu n’as aucune liberté : tu ne peux pas cesser d’être là, debout ou couché, inutile et nu. Tu n’as ni passé, ni avenir. Tu es celui du présent. Tu es une présence qui ne signifie rien. Tu es un personnage objet. Mon objet. »
Le trio n’apparaît jamais. Des scènes s’enchaînent en duo, suggérant un aille e varie des nuances chaudes à froides, projetant des bribes d’images de vapeurs et de chairs sur les murs. Ce lieu indéfini, nous perd entre chimère et réalité, à l’instar du troisième personnage, qui navigue entre concret et songe.
e varie des nuances chaudes à froides, projetant des bribes d’images de vapeurs et de chairs sur les murs. Ce lieu indéfini, nous perd entre chimère et réalité, à l’instar du troisième personnage, qui navigue entre concret et songe.
Parfois vêtus, parfois nus, parés de draps blancs, Emmanuelle Béart et Laurent Sauvage nous renvoient aux divinités grecques. Le masque autoritaire de la femme insoumise et sensuelle, lui sied à ravir. Emmanuelle Béart, dégage une assurance et une volupté probantes. Elle se balance entre poigne érotique et affaiblissements incertains. Elle incarne la Femme dans ses multiples complexités. Sous son commandement deux hommes, diamétralement opposés. Le premier, le plus proche, officiellement, de la femme, est interprété par Laurent Sauvage. Il oscille avec discrétion entre désincarnation de son corps, devenu matériel, et affirmation de ses envies. Prisonnier de son être intérieur, il cultive le mystère et malgré tout, une forme d’indépendance. Le deuxième homme, qui chemine entre la femme et l’homme, est constamment nu. Nu, comme un dieu Grec, exhibant la beauté de l’homme dans son entité. Nu, comme une offrande, réduit à un sexe. Nu, car dématérialisé et presque irréel, ne se rattachant à rien de tangible. Thomas Gonzalez, marche sur le plateau et s’agite comme un lion en cage. Le spectateur fait abstraction de sa nudité justifiée et se raccroche à sa solitude touchante. À l’inverse de dans « Je suis Fassbinder », il découvre un visage fragile. Incarnant les interrogations et la conscience d’un monde délaissé, qui brûle du besoin de l’autre.