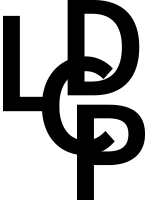Pourquoi avoir fait le choix de cette reprise d’Inventaires ?
Dans mon parcours de théâtre, j’ai fait beaucoup de mises en scènes pendant très longtemps. Puis, je me suis arrêté pendant trois ans pour aller au 104 faire des documentaires. J’ai un peu arrêté l’art théâtral car j’avais envie d’être dans la transmission, mais dans d’autres pratiques artistiques. À la fin de cette période, j’ai eu besoin de faire un point concernant mes envies de faire du théâtre. J’ai retrouvé Minyana et on s’est reparlé de projets à venir, dont une pièce que l’on doit faire dans deux ans. C’est dans la mouvance de ce chantier vers un autre projet qu’on a repensé à notre parcours et qu’on a trouvé qu’Inventaires avait été un théâtre manifeste. A l’origine, le fait que les lumières restent dans la salle, cette façon de parler au public, cette limite avec le mauvais goût, le Café-Théâtre étaient des éléments qui, en 1987, avaient fait grincer. Pour nous, cette forme représentait un théâtre anti-machines et anti-images. Nous avons voulu reprendre la pièce pour voir ce qu’il en était de cette forme, vingt-sept ans plus tard. Depuis trois ans, je travaille comme plasticien ou performer sur des sujets parallèles, comme les séminaires de Deleuze sur le cinéma, à la Ménagerie de verre. À cette occasion, j’ai beaucoup réfléchi sur la question des reprises. Qu’est-ce qui vieillit ? Dans le théâtre, on reprend peu ; il est rare qu’une équipe ait le luxe de faire ça. Nous voulions rejouer cette pièce comme on ressort un film et voir ce que le temps avait eu comme impact. Au départ, c’était un projet théorique qui nous faisait peur. Les comédiennes sont beaucoup plus âgées, la forme qui, à l’époque, paraissait très moderne, est devenue habituelle, même si tout est très travaillé. Ce qui est devenu concret et sensuel, c’est lorsque j’ai parlé aux trois comédiennes qui ont été d’accord. Sans cela, la reprise aurait été absurde ; on aurait repris un texte, pas le spectacle. C’est curieux car je pensais qu’il y aurait eu plus de personnes qui analyseraient la pièce dans ce sens. L’idée était de ne surtout rien changer pour savoir si, avec cette reprise, on ferait resurgir des fantômes qui étaient dans le corps de ces femmes, il y a vingt-sept ans. De plus, chacune a accepté, à la condition que les deux autres acceptent également ; ce qui prouve leur liaison. On a imaginé la reprendre autrement, mais l’intérêt réside dans le fait que ce soit exactement la même chose. Ce qui a changé, ce sont leurs corps, leurs voix ; c’est elles. Lorsque Judith Magre parle de la mort, il y a vingt-sept ans, et de la mort, aujourd’hui, cela n’a rien à voir ; elle en est beaucoup plus consciente.
N’avez-vous pas eu peur que cette scénographie un peu kitsch déplaise, justement par ce côté daté ?
La scénographie est dépendante du Théâtre de Poche-Montparnasse, du spectacle qu’il y a après. En tournée, l’idée est de simplement poser un tapis au sol. On jette la chose dans l’espace sans commentaires. Or, là, tout le commentaire des murs vient du décor du spectacle d’après, auquel il faut s’adapter. Ce kitsch est plus brut, comme du cirque. On monte et on démonte tous les jours pour amener un côté usé et des airs de baraque de foire. Dans foire, il y a « foireux » et il fallait qu’il y ait cet aspect-là lorsque ces femmes viennent parler. Il fallait qu’il y ait un côté « ripoux » et mal fini, sans en faire la citation. Ce vocabulaire-là est important et, pour le coup, n’a pas tellement changé au fil de ces années.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’écriture de Minyana ? Est-ce le théâtre de la vie ?
Avec Minyana, cela fait trente ans que nous nous connaissons ; j’ai monté douze pièces de lui. Au départ, nous sommes dans le même cours de théâtre ; c’est une histoire affective où nous nous entraînons dans nos plaisirs communs : lui, le théâtre ; moi, les arts plastiques. Nous n’aimons pas le théâtre où il y a beaucoup de machineries ; nous aimons la vertu que le texte peut avoir de ne pas se stabiliser. Nous avons le goût des écarts, l’idée de mélanger des acteurs monstres et des amateurs. De plus, nous sommes tous les deux transmetteurs et formateurs. Au-delà de tout cela, j’aime son écriture, je me sens à l’aise avec ; elle me parle, donc elle doit parler d’un monde qui me va.
Votre direction au 104 a-t’elle renforcé cette envie d’ouverture aux autres arts ?
À la base, je n’ai pas une formation théâtrale comme ceux qui sortent d’écoles d’arts. C’est donc en tordant les Arts Plastiques que j’ai aimé le théâtre d’art , issu de la fréquentation des textes d’Appia, de Craig, Meyerhold, Antoine. Au théâtre, je ne me sens jamais vraiment chez moi. J’ai beaucoup de mal avec les décors, avec le jeu. Je cherchais, alors, un endroit où faire un laboratoire permanent des formes. Je trouve que le théâtre, en France, a beaucoup de mal à entretenir ces laboratoires. Nous sommes souvent obligés d’être dans la production d’œuvres finies. Le peu de lieux qu’il y avait ont disparu. Il reste encore quelques endroits, comme la Ménagerie de verre, avec la danse. La danse est surprenante car elle a toujours entretenu cette volonté. Ils sont capables de faire des spectacles de quinze minutes, dans quatre lieux différents et de les assembler. C’est beaucoup plus riche et souple dans le rapport production et exposition des signes. Il est difficile de durer dans la mise en scène ; beaucoup s’épuisent et sont obligés d’avoir du pouvoir afin de ne pas s’avouer qu’ils n’ont plus de talent. L’occasion du 104 avec Frédéric Fisbach m’a permis de tenter quelque chose tout en sachant qu’on arrêterait à un moment. J’avais cette envie et elle s’est confirmée en faisant le 104. Ce fut très enrichissant de rencontrer des paysagistes, des designers, des musiciens. Il y a eu des transversalités très joyeuses qui m’ont conforté dans l’envie de ne pas être à un endroit précis. Le documentaire est vraiment l’opposé du théâtre. En en faisant, on est en prise avec le réel, alors qu’au théâtre on recrée le réel. Ce fut tellement excitant, que pour revenir au théâtre, il me faut des histoires d’amours profondes, des histoires de nécessité, sans enchaîner les mises en scènes.
Quelle est votre vision du théâtre aujourd’hui ?
Si on veut bien voir le sujet, il faut faire un pas de côté, un contrechamp. J’ai dû sortir du théâtre pour mieux le voir. Je trouve passionnant qu’il y ait un nombre de personnes, un spectre de tous âges qui, ensemble, se regardent, s’influencent et s’observent. C’est d’une richesse incroyable. Au cinéma, c’est très compartimenté. La difficulté est de savoir comment faire pour que des lieux qui sont d’une fragilité « officielle » existent. Malheureusement, même quand il y avait de l’argent, ces lieux de tentatives d’essais n’existaient pas. Dans certains endroits comme la Ménagerie de verre, les choses se font. J’ai pu monter un Faust en ayant l’opportunité d’effectuer un travail d’essai. Dans les grands lieux, nous avons l’impression que toute l’énergie s’est épuisée. Les obligations institutionnelles font qu’il y a une antinomie entre ce que le geste artistique transporte et ce qui est formaté. Je pense qu’il y a une normalisation qui s’impose, alors que le théâtre est un lieu d’invention des rapports dénormés. On voit des formes inventives mais sur-cadrées. On a pratiquement tout fait, tout en restant dans un cadre très millimétré, parfois bourgeois. Le théâtre a un avenir radieux, mais il faudrait réinventer les modes de production. Je pense que le théâtre a encore tout à faire.