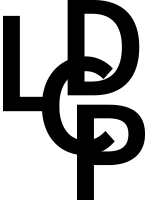Après Les Particules élémentaires, de Houellebecq, l’année dernière, Julien Gosselin poursuit son intérêt pour le roman et monte 2666, de Roberto Bolaño. Un roman titanesque de cinq parties, un spectacle haletant de 11h30, entractes comprises.
Après Les Particules élémentaires, de Houellebecq, l’année dernière, Julien Gosselin poursuit son intérêt pour le roman et monte 2666, de Roberto Bolaño. Un roman titanesque de cinq parties, un spectacle haletant de 11h30, entractes comprises.
De Londres à Turin, de la France en passant par Harlem et toujours pour rejoindre le Mexique, les premières intrigues ont un point commun : la violence qu’on s’inflige à soi, à l’autre et la quête impossible. L’insatisfaction naît et tout se concentre sur les sentiments humains et l’obligation de se confronter à soi et à sa folie.
L’action est prenante, l’écriture limpide, poétique et impitoyable. Immergés, comme dans une enquête policière, les deux premières heures sont fascinantes. Nous sommes désireux de connaître la suite et de nous plonger à corps perdus dans cette atmosphère déroutante et parfois inconfortable.
Les lumières sont jaunis et tamisées. Les corps se laissent aller à leurs pulsions. Tout est franc, cru mais jamais vulgaire. Le brut et l’essentiel sont comme dans la réalité de notre fiction, comme dans notre imagination lorsque nous parcourons un roman. La littérature occupe une grande place dans la structure et produit beaucoup d’effet chez chacun. Le metteur en scène, parvient à recréer, sur le plateau de La Fabrica, l’addiction que procure un bon roman : le manque lorsqu’on fait une pause, la tristesse de l’achever et de rejoindre la réalité. Le lecteur s’attache aux personnages et parcoure les pages avec avidité. Ici, le spectateur s’attache aux comédiens et se laisse porter par leur quête littéraire et poétique. La littérature comme échappatoire, une fuite pour se sauver du réel, un remède contre sa propre vérité, trop extrême.
Les comédiens sont justes et singuliers, naturels et intrigants. Ils évoluent à l’intérieur et devant une structure intéressante, de plus en plus à la mode sur les plateaux. Plusieurs compartiments, des blocs sur roulettes, à taille humaine, représentent des espaces familiers. Ils sont occupés par des décors réalistes, symbolisant plusieurs lieux : salon, chambre, hall d’hôtel, terrasse… Au-dessus de ces cubes se tiennent deux musiciens au doigté lyrique et effréné.
Si la première partie est une réussite qui laisse rêveur, avec la sensation de découvrir un vent nouveau, la seconde partie, réduit tous nos espoirs à néant. Une partie de 1h10, pendant laquelle la vidéo est omniprésente. Le spectateur passe cette heure rivé à un grand écran qui retransmet tout de la scène, même les visages des corps, qui trop éloignés, sont imperceptibles. Du roman, au théâtre nous atterrissons au cinéma. Une vision est alors imposée, celle de la caméra. L’œil n’est plus libre de cibler à sa guise. Tout le monde est dans le même panier et ne réfléchit plus. Du spectacle VIVANT, qui par le biais de la technique, même si c’est du live, n’en est plus tellement.
De plus en plus présente sur les planches des Théâtres, l’usage maladroit et excessif de la vidéo, transforme les angles et les points de vue. Elle détruit la spontanéité et la présence du comédien, indispensables au Théâtre.
Mais ne blâmons pas trop vite ce spectacle dont il reste les trois parties suivantes à découvrir à partir du 10 septembre au Théâtre de L’Odéon. Une suite, qui si elle est à la hauteur du premier volet, s’annonce riche de sens et de bouleversements.